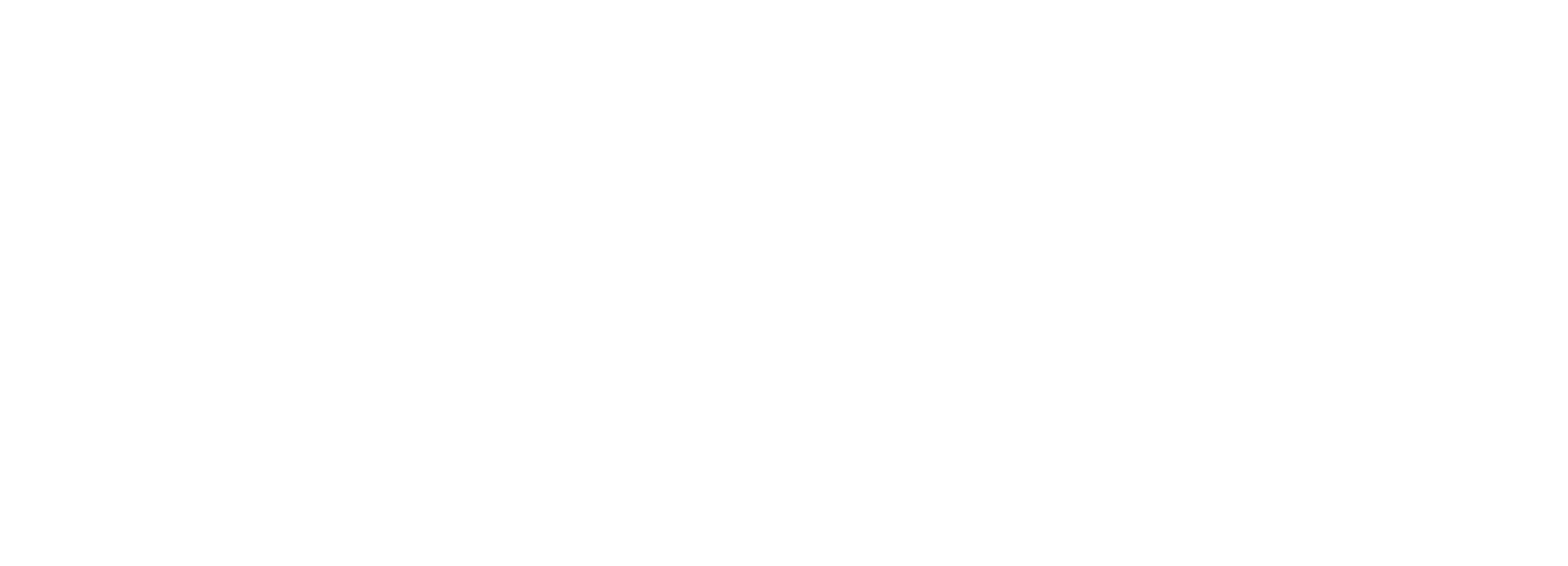Cette série de textes de réflexion ont pour objectif de fournir un éclairage autour de certaines questions que la guerre en Ukraine a contribué à soulever, à savoir les causes de ce conflit, l’efficacité et la moralité des sanctions économiques imposées à la Russie, sur l’irrationalité de Vladimir Poutine ainsi que les perspectives d’avenir de ce conflit non seulement sur les relations russo-ukrainiennes, mais aussi sur le monde global qui est en train de se dessiner à travers ce conflit. Cette note est la troisième dans cette série. Pour lire les deux premiers, cliquez ici et ici.
Comme l’a écrit Voltaire en 1764 dans le Dictionnaire philosophique, « la guerre est un fléau inévitable », mais elle n’en reste pas moins « le partage affreux de l’homme ». Voilà sans doute pourquoi les sociétés humaines ont depuis des siècles insisté sur l’importance de limiter le plus possible les préjudices qui devraient être tolérés en temps de conflit. Dans cette perspective, la règle de loin la plus importante est celle de la discrimination entre les personnes considérées comme combattants et les non-combattants qui exige de ne prendre que les premiers pour cible. Une incapacité à faire cette distinction ouvrirait toute grande la porte au barbarisme et à la guerre totale.
Pendant les conflits, la violence contre les personnes ne se limite pas uniquement à celle sur le champ de bataille, mais aussi à toute la gamme des politiques mises en place par les états et pouvant avoir des conséquences néfastes sur ce principe de la discrimination. Dans le cas ukrainien, les sanctions économiques imposées à la Russie ont des conséquences similaires à des armes de guerre et, lorsque déployées de manière indiscriminée, peuvent se révéler être des armes de destruction massive. Malheureusement, c’est le cas des sanctions occidentales contre la Russie qui auront à terme des impacts non seulement sur le peuple russe, mais aussi sur des millions d’individus un peu partout dans le monde.
Tout d’abord, il ne fait aucun doute que les sanctions ciblées contre Vladimir Poutine lui-même, ses ministres, les oligarques russes proches du pouvoir et députés qui ont voté en faveur de la reconnaissance de l’indépendance des républiques de Donetsk et de Louhansk étaient justifiées, dans la mesure où ces individus ont volontairement engagé leur responsabilité personnelle dans ce conflit. Toutefois, il en va tout autrement avec les sanctions qui ont suivies et dont le but avoué était d’étouffer l’économie russe, puisque les personnes qui seront le plus impactées par celles-ci se trouvent à être des millions de Russes qui n’ont rien à voir dans la décision d’engager leur pays dans cette guerre d’agression.
En effet, en vertu de quelle logique est-il légitime de prétendre que ces gens ont, même indirectement, engagé leur responsabilité dans ce conflit ? Parce qu’ils ont élu Vladimir Poutine au pouvoir et offert une majorité de sièges à la Douma aux partis qui le soutiennent ? Pareille explication ne fait aucun sens dans un État où les élections n’y sont pas libres. Parce qu’à l’exception de quelques courageux, ils ont fait le choix de ne pas manifester leur opposition à leur dirigeant ? Leur silence les rendrait donc complices ? Cette justification ne tient pas non plus la route lorsque l’on connait la nature des sanctions pénales qui sont réservées aux opposants. Parce qu’ils paient des taxes et des impôts à leur gouvernement dont une partie est par la suite investie dans le complexe militaro-industriel russe ? Si le concept du citoyen souverain n’est pas accepté chez-nous, imaginez simplement quel est son accueil au pays des tsars. En d’autres termes, malgré toutes les contorsions mentales imaginables, il est difficilement envisageable de justifier des sanctions aussi drastiques contre eux.
Les conséquences des sanctions se font déjà sentir sur le peuple russe, puisque la dévaluation du rouble russe a inévitablement contribué à une augmentation des prix dans le pays, ce qui condamnera ces gens—qui vivent déjà dans un état de pauvreté—à devoir se serrer encore davantage la ceinture, à affronter la faim et, dans le cas des mères célibataires, à devoir faire un choix répugnant, mais nécessaire à la survie de leurs enfants.
Par ailleurs, même pour ceux et celles qui osent encore prétendre qu’il est légitime de cibler la population civile russe, il est à noter que l’impact de ces sanctions ne se limitera pas simplement à eux, mais aussi à d’autres régions dans le monde et à leurs habitants contre qui la crainte d’une crise alimentaire de grande envergure pend au-dessus de leurs têtes telle une épée de Damoclès. En effet, il ne faut pas oublier que la Russie est le premier exportateur mondial de blé (20% des exportations mondiales) tandis que la part de l’Ukraine représente 12% des exportations mondiales. À toutes fins utiles, il n’y aura pas de récolte dans ce pays cette été et la Russie est désormais incapable de vendre cette ressource ailleurs dans le monde. Conséquemment, il faut donc s’attendre à une pénurie mondiale de blé, de maïs et autres grains plus tard cette année, ce qui entrainera une explosion des prix sur le marché (une explosion qui sera en outre décuplée par la hausse des prix du pétrole qui aura également une influence sur le coût de transport de cette denrée essentielle) pour ces produits qui sont à la base de l’alimentation de millions de personnes dans le monde qui ne jouissent malheureusement pas de la même sécurité alimentaire que les Occidentaux. Pensons par exemple à l’Égypte, le premier acheteur mondial de blé, dont plus de 80% de ses importations proviennent de la Russie et de l’Ukraine. Leur dira-t-on qu’ils n’ont qu’à manger de la brioche ? En raison de notre indignation émotive qui n’est jamais la meilleure des conseillères dans le domaine de la politique, sommes-nous en train de refaire le coup des sanctions imposées à l’Irak après la Première guerre du golfe en 1991 et qui auraient coûté la vie à près de 500 000 enfants irakiens[i] et qui a servi, jusqu’à présent du moins, d’exemple à ne pas suivre ?
Encore une fois, des innocents seront les victimes collatérales de ces sanctions qui, si elles persistent, resteront dans l’histoire comme l’alternative à la guerre la plus meurtrière de l’histoire. Les dirigeants occidentaux qui ont imposé ces sanctions devraient avoir du mal à trouver le sommeil la nuit qui, dans leur indignation causée par l’agression russe, ont pris des décisions précipitées et, je crois qu’on peut aussi le dire, franchement immorales en raison de leur caractère indiscriminé.
En parallèle à cette question, il importe également de chercher à comprendre quelle est l’efficacité réelle des sanctions discriminées et imposées à ceux et à celles qui ont engagé leur responsabilité morale dans ce conflit.
Tout d’abord, il importe d’avoir une vision claire de ce à quoi consiste le régime autoritaire de Vladimir Poutine dont l’organisation rappelle dans les faits celle des grandes organisations mafieuses et du crime organisé. À la tête de la pyramide, le chef de l’État fait office de parrain dont le rôle consiste à faciliter l’enrichissement des principales élites économiques du pays. En retour, les bénéficiaires directs de cette manne, qui sont les oligarques les plus riches du pays, ont une responsabilité similaire à l’endroit de ceux qui se trouvent sous leur dépendance directe et ainsi de suite. Voilà la raison pour laquelle la Russie est souvent comparée, et non sans raison, à une « cleptocratie » et les grandes fortunes des hommes d’affaire proches de Poutine le prouvent très bien[ii]. L’objectif qui se cache derrière les sanctions économiques imposées à la Russie en 2014 suite à l’annexion de la Crimée auxquelles se sont ajoutées de nouvelles mesures contre Vladimir Poutine lui-même et les principaux oligarques du pays est de briser le lien de confiance entre le parrain et ses « capos » en gelant les avoirs de ces derniers à l’étranger et en limitant leurs capacités d’emprunt dans l’espoir qu’elles en viennent à les inciter à remplacer leur chef au profit d’un nouveau parrain dont les décisions seront davantage favorables à la satisfaction de leurs intérêts personnels.
Mais cet espoir est-il fondé ? Sans pour autant en tirer des conclusions définitives, ce qui reviendrait à sombrer dans le piège qui consiste à prédire l’avenir, il y a des raisons de douter que ces sanctions auront les effets escomptés. Outre le fait qu’il y a des raisons de croire que les sanctions économiques n’ont jamais fonctionné dans le passé[iii], l’optimisme lié à une possible efficacité de ces sanctions repose sur notre tendance à analyser la Russie sous l’angle d’une structure étatique comme celle que j’ai décrite précédemment, à savoir un état mafieux. Cela n’est vrai qu’en apparence. Car si l’objectif demeure de favoriser l’enrichissement personnel du chef de l’État et de ceux qui l’entourent, les capos ou les oligarques du régime ne jouissent plus d’une indépendance réelle à se faire entendre à l’intérieur de la structure et une capacité à influencer la politique. Il est à noter que cela n’était pas le cas auparavant lorsque Boris Elstine gouvernait le pays. Les oligarques jouissaient d’un pouvoir politique considérable (certains avaient même des postes ministériels) après s’être enrichis rapidement à la faveur des privatisations massives qui suivirent l’effondrement de l’Union soviétique.
Il en va tout autrement avec son successeur qui a pris grand soin de les éloigner de la politique en échange de quoi le Kremlin décida de fermer les yeux sur la façon avec laquelle ils accumulèrent leurs richesses. Ce faisant, Vladimir Poutine a été en mesure de libérer la sphère politique russe des griffes des élites économiques et de renverser le rapport maître-subordonné qui dominait sous l’administration Elstine. Les quelques oligarques qui ont refusé de jouer dans cette pièce ont subi les conséquences de leurs bravades. Comme le rappelle Andrey Kinyakin:
« Les oligarques éminents qui n’avaient pas accepté les conditions de [ce nouvel accord] et avaient osé contester la politique des autorités, ont dû s’exiler, tel Vladimir Gusinsky, le directeur de l’influent groupe financier et industriel Most, ou plus tard Boris Berezovsky, le plus célèbre oligarque de la période Elstine. D’autres ont été emprisonnés, tel le directeur de Yukos, Mikhail Khodorkovsky. Cependant la majorité de l’arrière-garde oligarchique est parvenue à survivre à ces purges, en acceptant les nouvelles règles du jeu et en démontrant sa loyauté au nouvel État-patron, incarné en la personne du Président Poutine »[iv].
En même temps, Vladimir Poutine a été en mesure de faire passer le capitalisme débridé de l’ère Elstine à un capitalisme d’État caractérisé par une intervention à grande échelle de l’État dans le contrôle des principales activités commerciales du pays. Ainsi, après son emprisonnement, les avoirs de Khodorkovsky furent transférés à une compagnie publique[v] et a mené à une accélération de la mainmise du Kremlin sur l’économie russe qui a fait passer sous son contrôle des entreprises jugées stratégiques dans les domaines pétrochimiques, du minerais, des entreprises automobiles ainsi que la compagnie aérienne Aeroflot avant d’atteindre son paroxisme en 2005 lorsque l’État a mis la main sur la compagnie Gazprom qui détient un monopole sur le gaz naturel du pays ainsi que sur 38 chaînes de télévision du pays, 10 stations de radio et de 3 sociétés internet. Ces compagnies furent en outre confiées à des proches et amis d’enfance de Vladimir Poutine issus de ce qu’on désigne aujourd’hui sous le nom de la « bande de Saint-Petersbourg », parmi lesquels faisait partie Dimitri Medvedev, celui qui garda au chaud le fauteuil présidentiel entre 2008 et 2012 alors que la constitution russe ne permettait pas à Vladimir Poutine de solliciter un troisième mandat. Ce sont ces individus que le Président russe connaît depuis plus de 30 ans et en qui il a confiance qui sont devenus les dépositaires de l’économie stratégique russe. Leur fidélité à toute épreuve est-elle non seulement attribuable aux postes qu’ils occupent et qu’ils se verraient retirer dans l’éventualité d’un changement de régime, mais également par le fait qu’ils partagent les mêmes idées que leur chef sur la place de la Russie dans le monde. Convaincus du bien-fondé des actions du Kremlin et conscients que leur sort personnel dépend également de l’issue de cette guerre, il serait éminemment surprenant de voir ces derniers se rebeller contre Vladimir Poutine. À cet égard, je me permets de citer une entrevue réalisée avec Bill Browder, l’un des rares financiers occidentaux à avoir pu profiter de la manne sous l’époque Elstine et qui a très bien résumer la situation actuelle des oligarques russes :
« Aucun d’entre eux n’a le moindre poids politique. Beaucoup sont les gardiens du trésor de Poutine et détiennent la majeure partie de l’économie. L’idée même de poids politique n’existe pas en Russie. Poutine prend toutes les décisions et les oligarques sont là pour son bon plaisir. En d’autres termes, il peut les remplacer dans la seconde s’il le souhaite. Quiconque pense que les oligarques pourraient se retourner contre lui à cause des sanctions se trompe absolument sur la manière dont le pouvoir fonctionne en Russie »[vi].
Dans les faits, la relation entre le Président russe et les oligarques est clairement unilatérale et est marquée par la domination complète du premier sur les seconds qui savent désormais qu’ils risquent d’être emprisonnés pour corruption et de voir tous leurs biens être confisqués par l’État pour la moindre critique à l’égard de Poutine ou pour refus de coopérer à ses projets. Cela signifie aussi que ces oligarques ne sont pas des « self-made men » et que leur fortune ne dépend pas de leur propre initiative. Au contraire, les compagnies qu’ils dirigent ne leur appartiennent pas, mais qu’ils en sont plutôt les simples dépositaires du pouvoir russe. Ils savent en outre pertinemment qu’un changement de régime en Russie les mènerait à tout perdre, y compris leur liberté puisque le risque serait grand qu’ils s’exposent à des poursuites judiciaires pour corruption et pour collaboration aux entreprises criminelles de celui qui leur a permis de s’enrichir. Certes, les sanctions ciblées contre eux vont leur faire perdre une fortune. Mais, au final, ils savent très bien qu’il y a un scénario beaucoup plus sombre qui les attend s’ils décidaient de se retourner contre leur maître. Dans les circonstances, il ne leur reste qu’un choix : la fuite en avant.
En somme, l’idée qui consiste à imposer des sanctions économiques peut s’avérer être une « fausse bonne idée » dans la mesure où elles peuvent non seulement en venir à avoir un impact néfaste sur des individus qui n’ont pas engagé leur responsabilité personnelle dans un conflit, mais aussi à ne pas mener aux conséquences politiques que l’on souhaite. Dans les circonstances, l’Occident ne devrait pas voir en elles la panacée par excellence qui permet de faire efficacement pression sur un État voyou au risque de totalement évacuer les efforts diplomatiques de la liste des options à privilégier. Car, au final, la plupart des guerres se terminent non pas par la destruction de son adversaire, mais plutôt par le compromis entre les parties qui ne peut qu’être le résultat de la discussion et de négociations.
Jean-François Caron (@jfrcaron) est professeur agrégé au Département des sciences politiques de l’Université Nazarbayev au Kazakhstan, ainsi qu’un chercheur senior avec l’Institut pour la paix et la diplomatie.
[i] Barbara Crossette, « Iraq Sanctions Kill Children, U.N. Reports », The New York Times, le 1er décembre 1995.
[ii] Anders Aslund, Russia’s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy. New Haven: Yale University Press.
[iii] Voir Nicholas Mulder, The Economic Weapons: The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War. New Haven: Yale University Press, 2022. Pourtant, cette thèse reste contestée.
[iv] Andrey Kinyakin, « Les oligarques dans la Russie contemporaine : de la « capture » de l’État à leur mise sous tutelle », Revue internationale de politique comparée, Vol. 20, No. 3, 2013, pp. 120-121.
[v] Inutile de dire que la condamnation à 10 ans de prison et la confiscation des biens de celui qui était alors l’homme le plus riche de Russie dont la fortune était estimée à 15 milliards $ a tétanisé les oligarques russes qui ont fait le choix de rentrer dans le rang.
[vi] Jean-Marc Gonin, « Bill Browder : la moitié de la fortune des oligarques appartient à Poutine », Le Figaro, le 10 mars 2022.