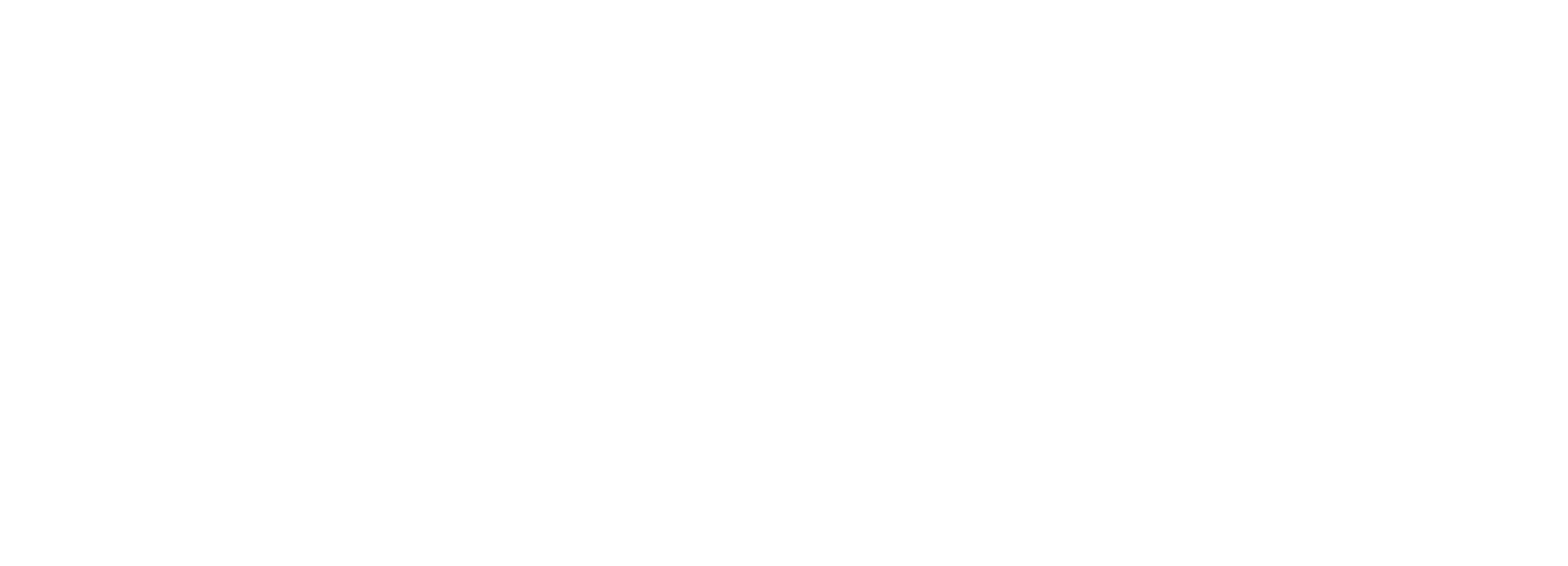Image credit: Kremlin
Cette série de textes de réflexion ont pour objectif de fournir un éclairage autour de certaines questions que la guerre en Ukraine a contribué à soulever, à savoir les causes de ce conflit, l’efficacité et la moralité des sanctions économiques imposées à la Russie, sur l’irrationalité de Vladimir Poutine ainsi que les perspectives d’avenir de ce conflit non seulement sur les relations russo-ukrainiennes, mais aussi sur le monde global qui est en train de se dessiner à travers ce conflit.
Avec l’invasion de l’Ukraine par les troupes de Vladimir Poutine, plusieurs ont vu dans ce geste le retour à un monde international anarchique et hobbesien au sein duquel les grandes puissances s’octroient désormais le droit d’attaquer des états plus faibles. Qu’en est-il réellement ? Et si Vladimir Poutine ne faisait que reproduire la logique étasunienne des 30 dernières années marquée par des actions unilatérales et souvent en contradiction avec le droit international ?
La décision d’engager son pays dans une guerre n’est jamais le résultat d’un coup de tête de la part d’un dirigeant politique, aussi peu démocrate puisse-t-il être. Cette décision résulte habituellement, mais pas toujours bien entendu, de ce qu’on appelle un « dilemme de sécurité », c’est-à-dire lorsqu’un État voit un autre État—ou une organisation destinée à la coopération militaire—augmenter sa puissance militaire, donnant ainsi à la première le sentiment que sa sécurité est en danger. Voilà qui explique la raison pour laquelle les tensions entre la Russie et l’Occident n’ont fait qu’augmenter au cours des 20 dernières années pour mener à la guerre que nous connaissons maintenant en Ukraine.
Or, il importe de rappeler que la Russie a vu venir depuis longtemps ce qu’elle considère être non seulement une menace à sa sécurité, à savoir une expansion toujours de plus en plus importante de l’OTAN qui frappe maintenant aux portes de ses frontières, mais aussi son exclusion symbolique d’un ordre sécuritaire européen dont elle était délibérément exclue. Le premier véritable avertissement est venu en 2007 lors du discours de Vladimir Poutine à la Conférence de Munich sur la sécurité à l’occasion de laquelle il a rappelé les dangers inhérents au monde unipolaire issu de la Guerre froide : thèse qui a depuis été son leitmotiv en matière de politique étrangère jusqu’à son discours à la nation russe du 24 février 2022.
Afin de mieux comprendre cette thèse, il est utile de se replacer dans le contexte qui était celui en 1991 : après un peu moins de 50 ans de lutte contre le communisme, le nouvel occupant de la Maison blanche, Bill Clinton, a dû répondre à une question fondamentale qu’aucun autre président n’avait eu à se poser avant lui: suite à l’effondrement spectaculaire de l’Union soviétique, quelle devrait être la place des États-Unis comme seule puissance hégémonique dans le monde ? A posteriori, il est évidemment aisé de répondre à cette question, mais force est de rappeler que le Président Clinton et son administration prirent beaucoup de temps à choisir la voie à suivre. En effet, après plusieurs mois de critiques sévères qui reprochaient à la Maison Blanche ses tergiversations et son indécision face à cette question fondamentale, la décision fut de faire des États-Unis un acteur global activement engagé à exporter ailleurs dans le monde les vertus idéologiques ayant contribué à la grandeur et à la supériorité de l’Amérique.
C’est ainsi qu’est née l’idée de la convergence libérale qui se caractérisait par l’optimisme d’un monde (et d’un marché global) ouvert et fondé sur le dialogue, l’adhésion des nations à des institutions internationales perçues comme étant en mesure de régler les différents interétatiques (contribuant ainsi à éviter les dilemmes de sécurité), à une coopération en matière de sécurité globale ainsi que la primauté absolue accordée aux individus et à la jouissance de leurs droits individuels. Ultimement, cette approche fondée sur le dialogue et le respect du droit est pensé comme ayant un effet civilisationnel et modernisateur sur les États en sapant l’attrait des tendances isolationnistes et contraires au libéralisme. En vertu de cette logique, l’interdépendance et la soumission à un même ensemble de règles et de procédures sont pensées comme offrant des avantages similaires à ceux d’une sortie d’un état de nature hobbesien en générant un espace pacifié régulé par le droit et au sein duquel les entités ont voix au chapitre.
Cette Pax Americana avait donc pour objectif de décloisonner le projet libéral des marges fixées par la Guerre froide et de l’étendre au reste du monde. Cette nouvelle vision fut explicitée en septembre 1993 par le Conseiller de la Maison Blanche à la sécurité nationale, Anthony Lake, qui annonça que le successeur à la doctrine de l’endiguement, qui avait été le mot d’ordre de la politique étrangère étasunienne au cours de la Guerre froide, allait désormais être dominée entièrement, et non plus sporadiquement comme cela a pu être le cas entre 1945 et 1991, par une stratégie d’élargissement, c’est-à-dire l’élargissement de la communauté internationale à la démocratie et au libre-marché capitaliste. Ce discours, qui fut en soi presqu’aussi important que celui de Winston Churchill prononcé à Fulton en 1946 dans lequel il popularisa l’expression du « rideau de fer » et qui allait être prémonitoire de ce que la Guerre froide allait avoir sur les pays « libérés » par l’Armée rouge dans les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale.[1] Bien que le discours de Lake n’avait pas la prétention de suggérer une stratégie claire, il n’en reste pas moins qu’il s’appuyait sur une vision qui mena par la suite à une série d’actions en ce sens aux quatre coins du monde et souvent dans des zones dépourvus d’intérêts stratégiques pour les États-Unis. Il suffit de penser à cet égard aux interventions américaines en Somalie en 1993, en Haïti en 1994, en Bosnie-Herzégovine ainsi qu’au Kosovo en 1999. Dans ces 4 cas, les États-Unis eurent recours à une tactique qu’il n’avait jamais entreprise auparavant, soit une intervention militaire afin de venir en aide à des peuples en danger et ne jouissant pas de la possibilité de vivre sous un état de droit, dans le but d’y construire les institutions libérales aptes à y établir la démocratie et la prospérité.
De nombreuses nations qui étaient jadis opposées aux idéaux associés à la convergence libérale ont par elles-mêmes décidé de suivre cette voie. Ce fut notamment le cas de la Russie sous la présidence de Boris Elstine qui épousa avec enthousiasme « l’atlanticisme étasunien »[2] et s’engagea résolument en faveur d’une démocratisation libérale et d’une ouverture de son marché au reste du monde[3] : décision qui a valu au Kremlin un soutien indéfectible de la part de Washington. En effet, l’administration Clinton voyait chez Elstine la figure d’un individu prêt à rompre définitivement avec l’héritage soviétique et à faire de son pays un membre à part entière du monde libéral, d’où la raison pour laquelle la Maison blanche a multiplié les occasions visant à solidifier le pouvoir et le prestige du Président russe[4]. C’est en ce sens que Michael Mandelbaum a soutenu que :
« Pendant la période où il fut en poste, Elstine a dans une très large mesure manifesté son appui aux principes de la démocratie libérale. La Russie a organisé des élections qui furent globalement libres et justes. Le pays a permis aux médias d’opérer librement, la liberté d’expression et la liberté politique. Elstine a conduit une politique étrangère favorable à l’Ouest ou à tout le moins qui n’était pas défavorable à ses intérêts. Dans cette perspective, la décision de la part du Président Clinton de soutenir son homologue russe fut un très bon investissement »[5].
Or, si cette Pax Americana promettait de miser sur le multilatéralisme et la coopération entre les différents peuples, force est d’admettre que les actions de Washington ont souvent été en décalage avec ses engagements. En ce sens, cela ne peut que nous amener à relativiser l’idée selon laquelle le monde de 2022 serait confronté à une première depuis la Seconde Guerre mondiale, à savoir un pays qui s’engage dans ce que le Tribunal de Nuremberg a jadis désigné sous le terme de « crime contre la paix » en violant la souveraineté d’un autre membre de la communauté internationale. Du jamais vu depuis en plus de 80 ans nous dit-on, d’où la raison pour laquelle Vladimir Poutine est aujourd’hui comparé à Hitler et que le 24 février 2022 est maintenant l’équivalent du 1er septembre 1939 date à laquelle les armées allemandes ont attaqué sournoisement la Pologne.
Certes, à première vue, il semble donc que le monde qui se déploie devant nos yeux n’est plus régulé par les normes et les grands principes moraux qui ont été au cœur de la reconstruction de l’ordre international post-1945 mais a plutôt été remplacé par un environnement international chaotique où désormais chaque état peut attaquer son voisin à sa guise. En d’autres mots, les efforts de nos prédécesseurs qui ont œuvré à pacifier tant bien que mal un ordre à la base anarchique et déterminé par la volonté de puissance des états semble avoir échoué. Voilà du moins le constant dominant : l’ordre international est à la merci de l’appétit des plus forts et il faut s’en méfier.
Or, ce « nouveau monde sans norme » que l’Occident doit combattre résolument n’est en fait que le résultat logique du monde des 30 dernières années qui opérait déjà en absence de normes et qui était déterminé en grande partie par la volonté de puissance de l’hégémon étasunien. En effet, la Pax Americana comportait également en son sein une logique selon laquelle Washington se donnait le droit d’agir de manière unilatérale et s’estimait en mesure de se passer de l’aval du Conseil de sécurité des Nations Unies lorsque l’occupant de la Maison blanche ne le jugeait pas nécessaire. Ce fut plus particulièrement le cas au Kosovo et en Irak en 2003 où, est-il utile de rappeler, les États-Unis n’hésitèrent pas à violer la souveraineté d’autres nations, et ce, en rupture totale avec le droit international post-1945. Dans le premier cas, ce n’est que plusieurs années plus tard que les raisons évoquées pour renverser le dirigeant serbe Slobodan Milosevic menèrent à la création du principe de la « responsabilité de protéger », tandis que dans le deuxième cas les États-Unis menèrent clairement une guerre préventive sous un prétexte erroné: geste illégal en vertu du droit international.
Bref, cette période qu’on appelle celle de la « convergence libérale » était en fait anarchique et exempte de normes reconnues par les autres nations qui étaient plutôt imposées unilatéralement par les États-Unis. Le monde était alors déjà dans un état de nature hobbesien, ce que nous n’avons pas remarqué en Occident étant donné que celui-ci était favorable à nos intérêts et était porteur des valeurs qui nous définissent et qui nous sont chères. Il n’en reste pas moins que les risques inhérents à cette manière licencieuse et illimitée d’exprimer sa puissance furent remarqués par ceux qui étaient laissés en marge de « cet ordre désordonné », dont les Russes qui ont vu dans l’intervention au Kosovo (en pleine Pâques orthodoxe, est-il utile de le rappeler) le « péché originel » de l’OTAN qui a révélé au grand jour son vrai visage, à savoir une alliance militaire non pas uniquement défensive, mais bel et bien offensive et qui n’avait aucune gêne à attaquer unilatéralement des états souverains. L’aventure de Bush jr. en Irak quatre ans plus tard n’ont contribué qu’à confirmer que ce qui s’était passé au Kosovo n’était pas une simple dérive malheureuse des États-Unis, mais plutôt le début d’un nouveau modèle des relations internationales.
Vladimir Poutine s’était montré à l’époque extrêmement critique à l’égard de ce monde marqué par l’illégalité et l’unilatéralisme étasunien, d’où la raison pour laquelle il rappelait dans son discours de 2007 à Munich le danger inhérent de ce genre d’actions pour la stabilité même de l’ordre international et exigeait des États-Unis qu’ils cherchent plutôt à établir un ordre réellement multilatéral et basé sur le dialogue ainsi que sur l’égalité entre les nations. Or, il n’en fut rien et la Maison blanche a plutôt cherché dans les années suivantes à écarter cette option au profit d’initiatives toujours de plus en plus fortes au sein d’organisations qu’elle dirigeait et à la solde de ses orientations et intérêts, plus particulièrement l’OTAN qui a cherché à élargir sa sphère d’influence aux portes de la Russie d’abord en Géorgie en 2008 et plus récemment en Ukraine. Dans les circonstances, il ne faut donc pas être surpris que la Russie en soit venue à terme à s’estimer victime d’un ordre international figé au sein duquel ses intérêts étaient non seulement ignorés, mais menacés par une puissance qui n’avait jamais hésité à recourir à la force illégitime et illégale pour faire prévaloir ses intérêts et sa vision du monde.
Grand historien de la Grèce antique, Thucydide a laissé comme héritage à la science politique l’idée selon laquelle un conflit est quasiment toujours la conséquence normale d’une situation où une puissance exige une réforme du système mondial sur la base que celui-ci ne convient plus à l’affirmation de ses intérêts ou qu’il constitue pour lui une menace existentielle. Lorsque la puissance hégémonique refuse de modifier de quelque manière que ce soit le système en place, en plus de prendre des mesures préjudiciables aux intérêts de la puissance qui la critique, les États sont alors pris dans un piège (que l’on appelle désormais « le piège de Thucydide ») et la situation tend à s’envenimer rapidement au point où seule la guerre apparait à la puissance revendicatrice comme la seule voie de sortie lui permettant de dénouer l’impasse. Voilà comment il est possible d’expliquer la situation actuelle en Ukraine.
Malgré les récriminations continuelles de Vladimir Poutine depuis 2007, l’ordre sécuritaire mondial est demeuré figé et au lieu d’œuvrer à un véritable multilatéralisme basé sur le dialogue, Washington a plutôt continué à privilégier l’expression de ses intérêts par le biais de l’OTAN dont le territoire s’étend aujourd’hui à moins de 150 kilomètres de Saint-Pétersbourg depuis que l’Estonie s’est jointe à l’organisation en 2004. Conséquemment, pareille attitude n’a contribué qu’à exacerber les craintes et les doutes de Moscou quant à la sincérité de la rhétorique étasunienne de l’après-Guerre froide selon laquelle les États se devaient de cesser de se considérer comme des rivaux mutuels et devaient plutôt privilégier l’idée selon laquelle ils étaient en mesure de faire face aux défis globaux en tant que partenaires égaux par le biais du multilatéralisme. Au fil du temps, Moscou s’est graduellement convaincu que la rhétorique occidentale n’était pas en phase avec ses intentions réelles et qu’elle cachait en réalité une volonté de transformer l’unipolarité idéologique de l’après-Guerre froide en unipolarité stratégique dont l’objectif consistait à transformer les États-Unis en un hégémon en mesure d’imposer, non plus par la persuasion, mais plutôt par la force son modèle de société. C’est ce qui a amené Vladimir Poutine à penser (à tort ou à raison) que plus personne ne peut se sentir en sécurité dans pareil système et que si le droit international ne peut plus servir de refuge aux nations, celles-ci n’ont d’autres choix que de se tourner vers une course aux armements.
Dans les circonstances, la possibilité que l’Ukraine ne se joigne à l’OTAN était le coup de trop pour Vladimir Poutine qui s’est convaincu que la seule façon de forcer un changement à l’ordre international ne pouvait que se réaliser par la force et l’intimidation. Dans les circonstances, comment réagirait Washington si une puissance étrangère ayant au préalable fait la preuve à plusieurs reprises de sa volonté d’utiliser sa puissance militaire de manière unilatérale décidait de déployer, par exemple, des missiles nucléaires à quelques kilomètres de son territoire sous prétexte que les États-Unis ne devraient y voir aucune intention malveillante ? La question est purement matière de rhétorique et nous savons depuis la Crise des missiles de Cuba de 1962 que pareille initiative ne serait pas tolérée. En fait, l’exclusion de toute influence étrangère en Amérique fait partie intégrante de la stratégie étasunienne depuis la Doctrine Monroe élaborée en 1823. Il faut donc prendre la peine quelques instants de se placer dans les souliers de l’autre pour comprendre la raison pour laquelle Moscou reproche aux États-Unis d’avoir non seulement manqué à ses engagements en faveur du multilatéralisme et du rejet de l’unilatéralisme, mais aussi de prêcher une vision du monde que son propre gouvernement se refuserait à accepter s’il en était lui-même la victime. Il semblerait que Washington refuse d’appliquer à autrui sa propre logique géostratégique.
En somme, il est possible dans ce contexte d’affirmer que les États-Unis ont peut-être remporté (certes par défaut) la Guerre froide après que l’Union soviétique eut été victime de sa propre nécrose politique et économique, mais qu’ils ont « perdu leur victoire » par leur propension à recourir à la force militaire de manière unilatérale, ce qui n’a eu pour effet que de générer lentement mais sûrement des tensions qui se sont pleinement déployées sous nos yeux le 24 février 2022. Certes, on ne peut exclure une défaite russe en Ukraine et un changement de régime en Russie. Si le passé est garant de l’avenir, cela ne fera que renforcer l’unité occidentale, la propension à croire en la supériorité de son modèle et son unilatéralisme des 30 dernières années : attitude qui ne fera qu’accentuer encore davantage les écueils de la Pax Americana dans le domaine de la sécurité internationale. Car si la Russie peut être perçue comme un colosse aux pieds d’argile qui peut être maté, il en va tout autrement avec la Chine de Xi Jinping.
Jean-François Caron (@jfrcaron) est professeur agrégé au Département des sciences politiques de l’Université Nazarbayev au Kazakhstan, ainsi qu’un chercheur senior avec l’Institut pour la paix et la diplomatie.
[1] Dans lequel il affirmait : « De Stettin dans la Baltique jusqu’à Trieste dans l’Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent. Derrière cette ligne se trouvent toutes les capitales des anciens États de l’Europe centrale et orientale. Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et Sofia, toutes ces villes célèbres et les populations qui les entourent se trouvent dans ce que je dois appeler la sphère soviétique, et toutes sont soumises, sous une forme ou une autre, non seulement à l’influence soviétique, mais aussi à un degré très élevé et, dans beaucoup de cas, à un degré croissant, au contrôle de Moscou. (…) Les partis communistes, qui étaient très faibles dans tous ces États de l’Est européen, se sont vu élevés à une prédominance et un pouvoir bien au-delà de leur importance numérique et cherchent partout à accéder à un contrôle totalitaire. Des gouvernements policiers dominent dans presque tous les cas et, jusqu’à présent, à l’exception de la Tchécoslovaquie, il n’y a pas de vraie démocratie ».
[2] C’est ainsi que la diplomate Fu Ying, qui fut ambassadrice de la Chine aux Philippines, en Australie et en Grande-Bretagne, qualifie l’approche de la convergence libérale. Voir « How China Sees Russia : Beijing and Moscow are Close, but not Allies”, Foreign Affairs, Vol. 95, No. 1, 2016, p. 97.
[3] Robert Kagan, the Return of History and the End of Dreams, Knopf, New York, 2008. p. 7.
[4] Friedrich Nietzsche, The La Maison blanche et le Kremlin ont organisé pas moins de 17 rencontres officielles entre 1992 et 1999. Lors des événements de 1993 où un conflit entre les parlementaires de la Douma et le Président forcèrent ce dernier à faire tirer sur l’édifice du Parlement, Clinton réaffirma ouvertement son appui à son homologue en affirmant que ce dernier avait bien géré la crise (« Mr. Clinton praised the Russian President has having done “quite well” in managing the standoff with the Russian Parliament »), voir Douglas Jehl, « Clinton Repeats Supports for Yelstin », The New York Times, 30 septembre 1993. En outre, lors de la Première Guerre en Tchetchénie en décembre 1994, le Président Clinton n’hésita pas à comparer la situation à celle qu’avait connu les États-Unis au 19ème siècle au moment de la Guerre de Sécession et que la Tchetchénie était une partie intégrante de la Russie. Voir David Hoffman et John F. Harris, “Clinton, Yelstin Gloss Over Chechen War”, The Washington Post, 22 avril 1996. Finalement, après que des sondages aient indiqué la forte possibilité d’une défaite d’Elstine lors des élections présidentielles de 1996 contre son rival communiste, Gennady Ziouganov, la Maison blanche multiplia les efforts en vue de rehausser sa stature internationale et fit pression sur le Fonds monétaire international pour qu’il accélère la réalisation de projets devant favoriser sa réélection.
[5] Michael Mandelbaum, Mission Failure: American and the World in the Post-Cold War Era. Oxford: Oxford University Press, 2016, p. 56.